Remettre le citoyen au cœur du nouveau modèle de développement
Anticiper pour construire un nouveau contrat social répondant aux enjeux des urgences sociales et à la complexité des choix à opérer nécessite de prendre du recul afin d’imaginer des paradigmes innovants tout au long des étapes d’observation, de prospective et de production du développement durable et inclusif, dans le cadre d’un débat démocratique fécond sur l’évaluation de l’action de l’ensemble des acteurs de la vie politique, économique et sociale du pays.
Manque de cohérence et de convergence des stratégies sectorielles, importantes inégalités d’accès à l’éducation et la santé, une économie faiblement industrialisée et insuffisamment tournée vers l’innovation et l’exportation compétitive, décalage entre la création de valeur et d’emplois durables, une dette de l’État qui frôle le seuil de la soutenabilité, un système judiciaire lent, érosion des emplois agricoles à cause d’un exode rural accéléré, déficit de gouvernance du foncier agricole, une urbanisation en grande partie non planifiée et sans équipements et services en réseaux de qualité, persistance des poches de pauvreté et de précarité dans les zones rurales et périurbaines, disparités régionales et sociales sur fond de chômage élevé des jeunes, une classe moyenne urbaine et rurale censée jouer le rôle de locomotive du développement, encore embryonnaire, etc.
Autant de constats partagés par différentes études de diagnostic qui mettent en évidence, à qui veut écouter ou voir, l’incapacité de notre modèle économique et socio-politique à créer les richesses, améliorer le bien-être collectif et redistribuer équitablement les dividendes du développement, à cause notamment d’une gouvernance contreproductive des politiques publiques.
Le caractère vital et urgent d’un modèle renouvelé de développement, producteur d’une vision de l’avenir, interpelle aujourd’hui, plus que jamais, toutes les forces vives de la nation pour changer de cap et renforcer la gouvernance et l’efficacité des politiques publiques, tant à l’échelle nationale que locale et régionale.
L’avenir ne se prévoit pas, il se construit dans l’effort et la résolution
On ne peut plus aujourd’hui concevoir de nouvelles politiques publiques efficaces sans s’intéresser préalablement aux résultats obtenus par les politiques en vigueur et s’interroger sur la pertinence des objectifs et des choix stratégiques, sur la cohérence et l’efficience des actions et moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et sur la manière de répartir les ressources humaines et financières entre différentes actions.
L’ampleur et la simultanéité des défis des transitions (démocratique, économique, démographique, territoriale, numérique, sociale, alimentaire, écologique) rendent nécessaire un engagement collectif fort et coordonné, avec un sens élevé de la responsabilité et des urgence sociétales, et de réorienter prioritairement ces politiques vers une plus grande accumulation du capital immatériel, notamment à travers l’exploitation du pouvoir de l’intelligence collective et du potentiel de collaboration entre le gouvernement, les territoires, le secteur privé, la société civile et les universités.
Cela suggère une prise de conscience collective de l’impérieuse nécessité de mettre notre modèle de développement en phase avec les évolutions que connaît le pays, en mettant l’accent sur l’innovation sous toutes ses formes et l’augmentation durable de la productivité, tout en intégrant concrètement la saine gestion des deniers publics et les principes majeurs de bonne gouvernance, de justice sociale et de corrélation effective entre la responsabilité et la reddition des comptes.
Dans le même temps, il est crucial de lever, au préalable, les nombreux dysfonctionnements dont souffre la vie politique du pays, notamment à travers la réforme en profondeur de la gouvernance et du fonctionnement des appareils politiques et la pratique réelle d’une véritable démocratie représentative, à même d’obtenir l’adhésion des citoyens aux choix de politiques publiques et de restaurer leur confiance dans les institutions et les services publics.
Les communautés de pratiques : clé du trésor caché du savoir intangible
Il est bien établi maintenant que l’utilisation des médias sociaux, combinée avec les technologies web, pour mobiliser de grands groupes de participants peut aider à mener, à faibles coûts, des actions de collecte de données, de compilation et d’analyse plus rapides de l’information. L’objectif étant d’informer les décideurs et de faciliter les processus de décision et de planification stratégique, dans le cadre d’une démarche basée sur la méthode du “scenario planning participatif” mettant l’anticipation au service de l’action aussi bien au sein des entreprises que dans les administrations.
Aux Etats Unis, différentes régions ont maintenant recours aux techniques de planification par scénarios grâce au développement de plateformes logicielles interactives en ligne pour faire participer le plus grand nombre de citoyens dans la conception de modèles de développement et de leur déclinaison territoriale, à l’instar de Planit utilisée par Philadelphia City dans le cadre de la vision Philadelphie 2035, Mindmixer utilisée par Kansas City, CitiZing utilisée par l’état du Minnesota, etc.
Sur le plan opérationnel, l’observation des expériences internationales en matière de systèmes de création, de partage du savoir tacite ou intangible et de gestion des connaissances nous renseigne que les communautés de pratiques (CoPs) constituent des espaces de collaboration pertinents pour faire avancer, de manière continue, les réflexions sur divers domaines stratégiques et piloter des programmes de développement.
L’utilisation des CoPs dans le secteur public est bien illustrée en Angleterre et dans le Pays de Galles par le cas de l’Agence d’amélioration et de développement des collectivités locales (créée en 1998) qui a conçu une plateforme en ligne permettant le travail collaboratif, le partage des meilleures pratiques et la mise en relation de plus de 1500 communautés et de 100.000 adhérents avec les praticiens-experts du secteur public.
Devenue la plus grande plateforme de collaboration des secteurs publics au monde, ses services ont dépassé les seules frontières de Grande Bretagne pour servir ses membres dans plus de 12 autres pays en occupant la destination quotidienne où vont travailler ensemble le gouvernement central, les entreprises, les collectivités territoriales et les organisations non gouvernementales.
Autre exemple inspirateur d’utilisation des CoPs est celui de la “Project Management Institute“ (PMI), la plus grande association professionnelle au monde de gestion de projets, de programmes et de portefeuilles, fondée en 1969, et qui compte à son actif plus de 2,9 millions de membres dans pratiquement tous les pays du monde.
Les communautés des PMI sont des plateformes en ligne dédiées aux rencontres et aux échanges d’idées qui permettent de faire émerger le capital intangible, le partager, le développer et l’exploiter. Elles facilitent le perfectionnement des compétences grâce à l’apprentissage collaboratif et une plus grande capacité d’innovation des individus et des institutions, en capitalisant sur l’intelligence collective d’une plus grande diversité, et donc une meilleure représentativité des acteurs concernés et la consolidation de la légitimité de la communauté.
“La meilleure façon de prédire l’avenir c’est de le créer” – Peter Drucker
Dans son discours prononcé à l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de son accession au trône, le souverain revient sur la nécessité de réinventer notre modèle de développement : (…) Les dernières années ont révélé l’incapacité de notre modèle de développement à satisfaire les besoins croissants d’une partie de nos citoyens, à réduire les inégalités sociales et les disparités spatiales. C’est la raison pour laquelle Nous avons appelé à sa réévaluation et à sa réactualisation. (…).
Devant les enjeux et défis que soulève la problématique d’intégration et de convergence des politiques sectorielles, la régionalisation avancée et la déconcentration administrative, en tant que vecteurs de territorialisation de ces politiques, offrent aujourd’hui une plateforme idéale pour parvenir à une nouvelle dynamique de coopération et d’animation, et tisser la toile de fond sur laquelle les modèles spécifiques des régions du Royaume contribueront à la construction du nouveau modèle marocain de développement.
Des projets territoriaux structurants, leviers d’accélération du dynamisme économique, pourront ainsi voir le jour dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de développement régionaux (PDR), à condition toutefois d’opter pour une approche globale qui s’écarte de l’action individuelle et du travail en silos et privilégie la concertation, la participation de l’ensemble des acteurs et le travail collaboratif.
L’utilisation des communautés de pratiques pour le réajustement et l’opérationnalisation coordonnée des PDR apparaît comme une opportunité, non seulement pour mobiliser les acteurs autour des opérations régionales prioritaires, mais aussi aux fins de mutualiser et faire converger les efforts autour d’ambitions communes et de créer des emplois de qualité au sein d’entreprises compétitives à plus forte valeur ajoutée dans des territoires attractifs.
Ces communautés permettent de rendre opérationnelle et effective cette forme de participation, non comme une contrainte, mais plutôt comme une valeur ajoutée pour l’anticipation des futurs vraisemblables via la planification stratégique par scénarios, et le choix de projets de développement à caractères local, régional, voire national, répondant à des objectifs de dignité humaine et de rationalité économique et dont l’utilité sociale est partagée.
En effet, elles constituent des espaces d’écoute et d’échanges féconds et ciblés avec les différentes composantes de la société pour faire remonter les besoins, attentes et propositions, dresser l’état des réalisations effectives et les comparer aux objectifs fixés, et, in fine, évaluer de façon objective et indépendante le niveau d’efficacité des actions menées et d’amélioration du cadre de vie des citoyens, en prenant levier sur les technologies de l’information et de la communication.
Cela peut être considérablement facilité par des synergies collaboratives multi-acteurs (collectivités territoriales, établissements publics, entreprises privées, société civile, ingénieurs-conseils, experts, chercheurs, médiateurs, syndicats, responsables d’institutions scientifiques, techniques et financières…) pour l’élaboration de feuilles de routes partagées et traduites en véritables plans d’actions opérationnels, pilotés en bonne intelligence dans un cadre de gouvernance partenariale, ainsi que pour la promotion de l’innovation publique, de l’innovation sociale et de l’offre éducative, environnementale et culturelle inhérente à l’épanouissement des individus.
Le travail collaboratif en réseaux peut couvrir un large spectre de secteurs et thématiques, notamment la santé, l’éducation, le logement, l’agriculture, le tourisme, la mobilité, la prospective territoriale, les infrastructures, le financement, l’investissement, la fiscalité, la formation professionnelle, l’employabilité, les pôles de compétitivité, la promotion des PME, le partenariat public-privé, la modernisation de l’administration, la transformation digitale, l’efficacité énergétique, le changement climatique, etc.
Une telle démarche participative devrait permettre, avec l’aide de structures d’accompagnement souples et réactives, l’émergence, l’accélération et la mise en cohérence d’un portfolio d’une nouvelle génération de projets structurants à forts effets de levier sur l’ensemble des régions du Royaume, en capitalisant sur leurs avantages concurrentiels respectifs (clusters, incubateurs, pépinières, parcs scientifiques, plateformes technologiques, accélérateurs de start-up, centres de qualification et d’insertion professionnelle, nouveaux métiers mondiaux, industries du terroir, filières non agricoles, dispositifs d’innovation et de transfert de technologie, etc).
Mohammed Benahmed, Expert international en développement territorial durableI, diplômé du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE, auteur de plusieurs ouvrages et publications dans les domaines de la gouvernance et le financement des services publics, la régionalisation avancée, les politiques publiques, la digitalisation, les finances locales, la déconcentration, l’urbanisation, le PPP, l’économie bleue, les chaines de valeurs agricoles, les TPME, etc.
Share this content:


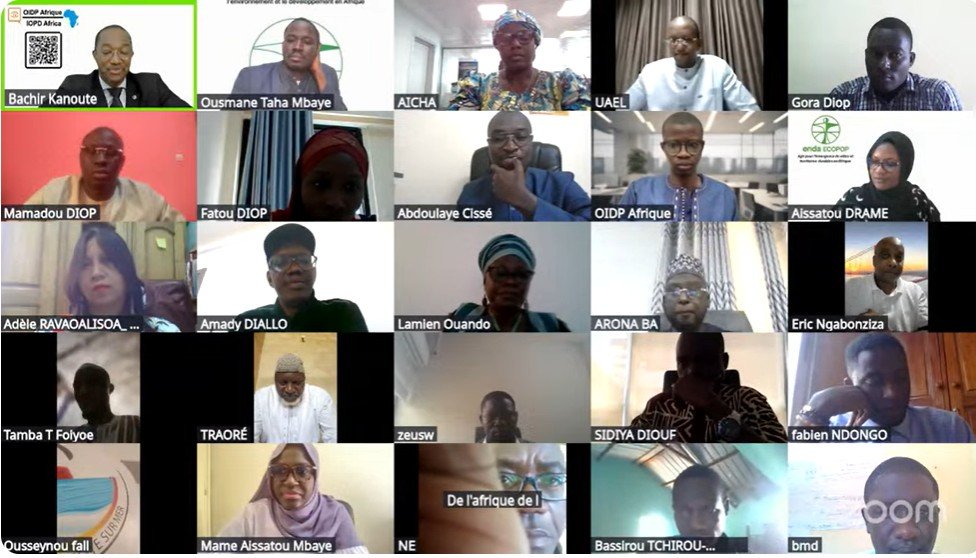



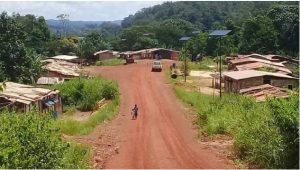







Laisser un commentaire