La Décentralisation, une opportunité pour faire du développement l’affaire de tous
Ce texte est une production de M. Amadou Touré, premier adjoint au maire de Saint. Une communication qu’il a présentée au séminaire international de l’UNESCO à Luang Prabang, au Laos,en Asie du Sud Est
1. Le processus de décentralisation au Sénégal : enjeux et réalités
Le Sénégal, à l’instar des Etats démocratiques d’Afrique et des autres parties du monde, a entrepris de renforcer son système de représentation et de participation des populations par la loi de décentralisation 96-02 qui prévoit 3 niveaux de collectivités locales : la région, la commune et la communauté rurale.
A chacun de ces niveaux est associé un organe d’exercice du pouvoir local résultant de l’expression du suffrage universel, sur listes majoritaires et proportionnelles ouvertes aux partis ou coalitions régulièrement constitués, pour un mandat uniforme de 5 ans, renouvelable.
Les hommes et les femmes ont un égal droit électoral : ils sont électeurs et éligibles sans ostracisme aucun.
Les 3 types de pouvoirs locaux reçoivent les mêmes compétences, exercées à des niveaux différents, autour de leurs Exécutifs respectifs : le Président du Conseil Régional, le Maire et le Président du Conseil Rural.
L’exercice de ce pouvoir est articulé autour de 9 domaines de compétences : la santé et l’action sociale, l’éducation, l’alphabétisation, la promotion des langues nationales et la formation professionnelle, l’environnement et la gestion des ressources naturelles, la jeunesse et les sports, la culture, la planification, les domaines, l’urbanisme et l’habitat, l’aménagement du territoire.
A l’évidence, le Sénégal a marqué dès 1972 sa volonté de décentralisation des responsabilités publiques par de grandes réformes en vue de faire du développement économique et social un enjeu à la portée des populations dont la mobilisation et la participation effectives restent le maître mot. C’est la promotion de l’auto développement.
Si ce système affranchit l’Etat des rigueurs découlant du centralisme pesant, il apparaît aujourd’hui aux yeux des élus locaux comme un moyen commode de transférer à la représentation locale des pouvoirs aux moyens symboliques pour ne pas dire inexistants.
En effet, en gardant sous sa charge et son autorité directes les fonctionnaires capables d’impulser la dynamique de la décentralisation, l’Etat marque sa prudence à travers le maintien musclé de la déconcentration, ce qui impose évidemment des limites réelles à la capacité de gestion des compétences institutionnelles transférées.
Souligner cette insuffisance stratégique et opérationnelle ne signifie nullement méconnaître la portée révolutionnaire de cette avancée démocratique, mais indique le devoir impérieux pour le Gouvernement du SOPI d’aller plus loin que ce que lui a légué le pouvoir précédent.
Les ressources humaines, organisationnelles, techniques et financières demeurent encore quasiment centralisées.
Se pose, une fois de plus, la problématique non point de la pertinence du système mais davantage de son efficacité.
Les capacités budgétaires locales sont insuffisantes pour soutenir les nombreuses actions prioritaires à entreprendre pour matérialiser les aspirations légitimes des populations à mieux vivre, loin de la pauvreté et du chaos générés par de longues années de mal administration qui ont ruiné les Etats Africains et paupérisé leurs villes et villages.
Le seul vrai refuge qu’il leur reste encore aujourd’hui, c’est leur culture millénaire adossée sur un sens inné de la communauté, de la solidarité, du libre respect de valeurs cosmogoniques sacrées.
A quelques variantes près et sous réserve de l’observance des règles de bonne gouvernance dans un Etat de droit constitué, le Sénégal et les autres pays africains partagent la même ambition de développement social et économique à travers la décentralisation locale et le fédéralisme continental, quels qu’en soient les limites actuelles ainsi que les impératifs d’approfondissement pour mieux répondre aux besoins des citoyens.
Le mouvement de décentralisation, aujourd’hui largement généralisé, renforce considérablement le rôle des autorités locales en matière culturelle.
Expression de la démocratisation de la vie publique, cette tendance offre également l’opportunité de « rapprocher » le patrimoine des populations, et de faire de sa mise en valeur un atout culturel et patrimonial certain, c’est-à-dire un véritable levier de développement économique et social local.
Indubitablement, c’est à cette échelle que peuvent être conciliées l’exigence de préservation du patrimoine pour les générations futures et celle d’amélioration des conditions actuelles de vie.
C’est en agissant au plus près des populations que le patrimoine peut devenir un réel outil de développement économique et social.
Grâce à une connaissance fine du territoire et de sa population, par le biais des outils de planification et de gestion urbaine développés au niveau local, les politiques patrimoniales peuvent être coordonnées avec les politiques urbaines et sociales, et notamment avec les politiques d’amélioration de l’habitat et de tourisme.
Affirmer le rôle des autorités locales dans la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine ne revient pas, loin de là, à nier le rôle de l’Etat.
Garant de la cohésion nationale et de la préservation du patrimoine du pays, l’Etat conserve un rôle régulateur et normatif essentiel.
Toutefois, les collectivités locales, en tant qu’opérateurs du développement à la base, deviennent des acteurs incontournables dans les politiques patrimoniales, foncières, touristiques et culturelles.
Et cette décentralisation culturelle constitue elle-même un moyen de promotion et d’approfondissement de la décentralisation politique, en offrant un support pour la participation communautaire et en stimulant l’émergence de projets culturels portés par les populations.
La légitimité des autorités locales dans la conception et la mise en œuvre des politiques culturelles n’est donc plus à prouver.
Mais au-delà d’une affirmation de la légitimité de la décentralisation culturelle, le défi aujourd’hui est d’améliorer son efficacité. Car force est de constater que, bien souvent, la décentralisation des compétences précède celle des ressources.
Fortes d’une mission élargie, les collectivités locales doivent avoir les moyens financiers, techniques et humains pour assumer les nouvelles responsabilités qui leur sont confiées.
2. Le patrimoine, outil de développement local et de lutte contre la pauvreté
Le patrimoine, une ressource pour le développement local
C’est pourquoi, venant de l’UNESCO qui réunit et protège la mémoire ainsi que la diversité culturelles de l’humanité, les projets patrimoniaux revêtent une importance décisive dans la stratégie globale de « lutte contre la pauvreté » entreprise par la communauté internationale en direction des pays pauvres dont les gouvernements ont ratifié avec ladite organisation une convention d’établissement de sites de patrimoine universel.
La culture étant pour chaque peuple ou communauté son bien identitaire le plus précieux et pour l’humanité un instrument puissant de rapprochement, la Conférence Mondiale d’Habitat II à Istanbul en 1996 a permis de faire reconnaître la décentralisation par les bailleurs de fonds comme un facteur essentiel pour l’amélioration des services aux populations.
Qui peut continuer encore à croire que la culture est «improductive» ou ne participe pas à l’accroissement des richesses ?
Certes, des problèmes juridiques complexes mais non insolubles liés au régime de propriété sur l’héritage culturel existent et incitent de plus en plus d’experts à élaborer des codes ou procédures facilitant la mobilisation des financements nécessaires pour la mise en œuvre effective des projets de patrimoine.
Le grand tournant que l’UNESCO et les gouvernements signataires de tels projets devraient négocier dans toutes les autres instances internationales (ONU, UE, ASEAN, USA-CANADA, UA… etc.) c’est de faire reconnaître par les Bailleurs de Fonds le caractère éminemment émancipateur et utile de la restauration du patrimoine culturel comme un facteur de progrès communautaire indéniable.
Du reste, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement, CHF/International et d’autres organismes internationaux de financement ont compris ces enjeux et s’engagent de plus en plus dans cette voie, par des montages et mécanismes qui gagneraient à être corrigés ou pondérés par les Etats.
Luang Prabang, un projet riche d’enseignements
Les activités de valorisation du patrimoine (tourisme, artisanat, commerces divers, services de télécommunications, restauration, pèlerinages…) que nous avons pu constater lors de l’atelier de restitution à Luang Prabang (Laos) sont facilement réplicables partout ailleurs dans le monde, en tenant compte des critères essentiels de succès :
– un site magnifique, point de rencontre merveilleux entre l’homme, la nature et l’histoire locale ou régionale
– une population sensibilisée et mobilisée sur les enjeux de la sauvegarde de son patrimoine
– un gouvernement décidé à accompagner, faciliter et pérenniser la politique de sauvegarde au terme du projet initial parrainé par l’UNESCO
– des architectes, ouvriers et artisans bien formés pour traduire concrètement le règlement et les normes d’architecture
– des autorités locales déterminées à respecter et faire respecter par tous leurs citoyens les normes établies
– des cadres de concertations représentatifs réunissant tous les segments de la communauté considérée
– enfin, des bailleurs de fonds vigilants, disponibles et coopératifs
Ce « miracle » existe, est possible et s’est dévoilé à nous au terme d’une semaine de travaux passionnants et enrichissants, sous l’impulsion remarquable de Mme Minja Yang et le concours didactique de toute la formidable équipe de la Maison du Patrimoine de Luang prabang (Laos) dirigée par mon ami, Monsieur Ouane Sirisack.
Evidemment, toute la bonté et la belle hospitalité des organisateurs, des populations et des autorités laotiennes seraient vainement déployées s’il n’y avait pas cette présence réconfortante d’experts de tous ordres mobilisés par l’UNESCO, qui nous ont beaucoup aidé à « situer » les rapports intimes entre patrimoine, argent, droit foncier et de propriété, PDU et Schéma de Cohérence Territoriale, assainissement et gestion de l’environnement, et…décentralisation !
Une opportunité pour être au service des populations
A Saint-Louis du Sénégal comme ailleurs, chez nos collègues de toutes les villes représentées à Luang Prabang, je le crois, une grande chance est offerte aux Maires ou décideurs politiques.
En effet, les Elus Locaux sont les mandataires de leurs Cités pour concevoir, valider et réaliser avec leurs populations les politiques urbaines qui répondent le mieux à leurs aspirations.
La décentralisation leur permet d’être l’interface entre l’Etat, ses impératifs de cohésion nationale et les citoyens aujourd’hui porteurs d’exigences nouvelles, d’une humanité qui refuse de diluer sa mémoire culturelle dans le confort moderne.
Et cette mémoire culturelle est le fondement, le cadre de référence basique de toutes projections de développement !
Cette nouvelle conception de la Gestion Locale impose une démarche de proximité et d’association étroite des populations. Elle réclame surtout de nouveaux partenariats.
En effet, comment associer les usagers aux décisions ? Comment gérer les compétences transférées à présent aux Villes sans s’entourer de toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires?
Ma conviction est que l’UNESCO, par cet atelier de vulgarisation de l’exemple de Luang Prabang, rappelle à tous les gestionnaires ou décideurs politiques que les Villes et la Culture sont aujourd’hui les centres du développement social,économique et culturel des communautés locales.
Cet atelier international aura permis de démontrer que les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Patrimoine (PSMV) sont des outils pédagogiques catalyseurs qui alimentent utilement les politiques de Décentralisation à travers les chantiers de « Promotion Communautaire du Patrimoine , d’élévation continue des sentiments patriotiques et civiques, de «Protection de l’Environnement», donc de l’éradication sûre de la pauvreté.
Par Monsieur Amadou TOURE,
1er adjoint au Maire de Saint Louis (Sénégal)
Share this content:


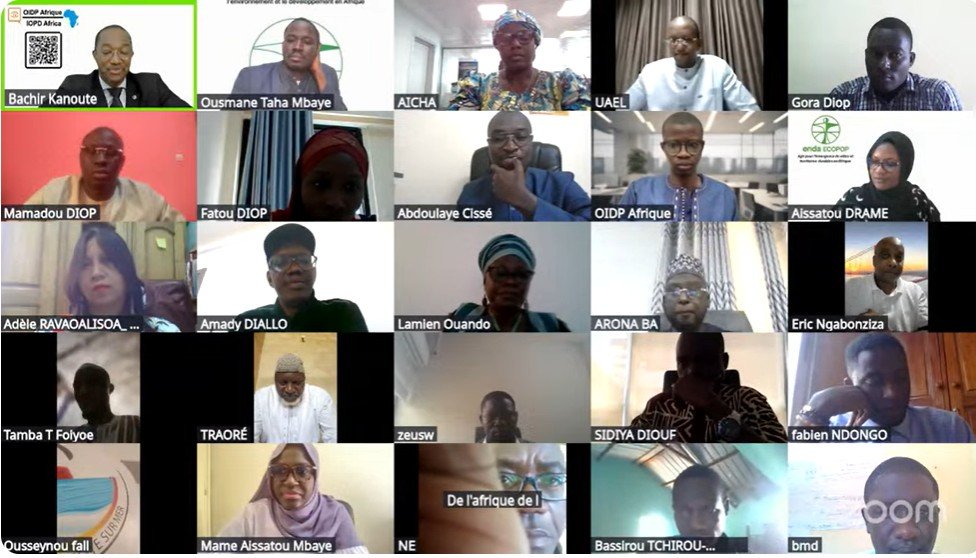



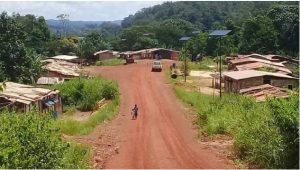







Laisser un commentaire