« La consécration de la participation citoyenne au Sénégal » par Mouhamadou Thiaw
La crise de confiance entre élus locaux et populations locales a légitimé les vagues de mouvement qui demandaient plus de place pour les citoyens dans la gestion des affaires publiques locales. En effet, la décentralisation, fondement des collectivités territoriales (personnes morales de droit public distinct de l’Etat), a débuté avec la démocratie représentative. Cette forme de démocratie suppose que le citoyen, à travers des élections, choisisse des élus qu’il va déléguer la gestion de la collectivité territoriale. Le citoyen, une fois qu’il choisit son représentant ne peut plus intervenir dans la gestion. L’élu local exerce le mandat jusqu’à son terme et ne rendcompte de l’exercice de ses fonctions qu’aux organes étatiques habilités à contrôler la gestion locale. Ainsi, ayant révélé des défaillances après des décennies de pratique, la démocratie représentative est aujourd’hui conjuguée avec la démocratie participative pour palier aux manquements et faire du citoyen acteur et finalité de la gestion locale.
La démocratie participative réapparait sur la scène de la décentralisation au début des années 1960 pour donner place à la participation citoyenne. Elle prône une gestion qui place le citoyen au centre des décisions. La participation de ce dernier n’est plus tout simplement intermittente. Le citoyen peut, au-delà du choix des élus locaux, intervenir pour donner son point de vue sur toutes les décisions ou projet entrepris par la collectivité territoriale, sur l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes de développement local menés dans sa collectivité. La participation citoyenne est devenue aujourd’hui, avec l’avènement du concept de développement local, un élément incontournable. Cette nouvelle approche de penser le développement qui consiste à le définir selon un territoire, avec ses potentialités et ses aléas, nécessite la mobilisation de tous les acteurs autour de projets essentiels qui se définissent dans les limites de la communauté. C’est dans cette logique que le Sénégal, à travers ses récentes réformes sur la décentralisation, entend construire, avec la participation citoyenne, des territoires viables et compétitifs et faire de la territorialisation des politiques publiques, jusque-là considérée comme un concept vide, une réalité.
La participation citoyenne est en effet, repensée dans la stratégie de développement à long terme du Sénégal, définie dans le document Plan Sénégal Emergent (PSE) et décidée par les réformes. Les orientations de la nouvelle politique de décentralisation baptisée Acte III, vise à privilégier la territorialisation des politiques publiques définie comme une approche visant à repenser la conception et la mise en œuvre des politiques publiques en vue de construire le développement du Sénégal à partir des potentialités, atouts et opportunités de chaque terroir ; de construire de territoires compétitifs viables et porteurs de développement ; d’élargir et d’approfondir la gouvernance locale. Parmi les valeurs et principes qui soutiennent ces orientations figurent : la transparence, l’accès équitable et égalaux ressources, la participation directe des citoyens à la prise des décisions des élus des collectivités locales responsables, par devers eux, du développement participatif de leur localité. Pour garantir le développement participatif qui est au cœur de la nouvelle politique de décentralisation, les autorités sénégalaises ont, à travers le dispositif juridique qui régit la décentralisation, consacré textuellement la participation citoyenne.
Dans un premier temps, la participation des citoyens à la gestion de leurs collectivités territoriales est consacrée par la constitution. Le titre XI de la constitution de 2001 modifié par la loi constitutionnelle n° 2016-10 du 05 Avril 2016 est intitulé : des collectivités territoriales. Dans ce titre, le constituant détermine la nouvelle politique de décentralisation envisagée par le Sénégal. L’article 102 de la constitution dispose : « Les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct. Elles participent à la territorialisation des politiques publiques, à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat ainsi qu’à l’élaboration et au suivi des programmes de développement spécifiques à leurs territoires.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi ». La lecture de cette disposition fait apparaitre clairement la consécration de la participation citoyenne. Cette disposition, en prévoyant que les collectivités territoriales constituent les cadres institutionnels de participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, pose en même temps le principe de la participation citoyenne et le cadre institutionnel dans lequel elle doit s’effectuer.
Ensuite, dans le cadre législatif, la participation citoyenne est prévue par la section II du titre premier de la loi de 2013-10 du 28 Décembre 2013 portant code général des collectivités locale. Cette loi dispose en son article 6 : « Toute personne physique ou morale peut faire, au président du conseil départemental et au maire, toutes propositions relatives à l’impulsion du développement économique et social de la collectivité locale concernée et à l’amélioration du fonctionnement des institutions.
Tout habitant ou contribuable a le droit de demander, à ses frais, communication, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil départemental ou du conseil municipal, des budgets et des comptes, ainsi que des arrêtés pris par l’autorité locale ». Cette disposition donne la possibilité aux citoyens locaux, indépendamment de toute initiative venant des conseils élus, de participer, à travers leurs propositions, à la mise en œuvre des politiques locales de développement et de veiller à l’amélioration des institutions locales. En plus, selon l’article 7 de la même loi, « En vue de garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques, l’organe exécutif local peut instituer, au sein de la collectivité locale, un cadre de concertation consulté sur :
-les plans et les projets de développement local ;
-les conventions de coopération et les contrats plans.
Le cadre de concertation peut, en outre, être consulté sur toute autre matière d’intérêt local.
Un décret détermine la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du cadre de concertation. ». A cela, il faut ajouter l’article 3 de la loi précitée qui dispose « Les collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, sociale et environnementale d’intérêt local. Les collectivités locales sont seules responsables, dans le respect des lois et règlement, de l’opportunité de leurs décisions. Elles associent en partenariat, le cas échéant, à la réalisation des projets de développement économique, social et environnemental, les mouvements associatifs et les groupements à caractère communautaire dans le respect de l’équité de genre ». Cette disposition montre une volonté manifeste du législateur de prévoir en toute clarté une obligation juridique pour les collectivités territoriales d’associer les citoyens dans l’élaboration des politiques de développement de leurs collectivités respectifs.
L’implication de la population dans la gestion des affaires publiques revêt d’une importance capitale car il permet de restaurer la confiance entre les citoyens et les élus locaux et renforce leur sentiment d’appartenance à leur localité. C’est en ce sens que le philosophe Aristote disait : « Un citoyen au sens absolu ne se définit par aucun autre caractère plus adéquat que par la participation aux fonctions judiciaires et publiques en générale ». Sans cette participation, les citoyens auraient le sentiment que la collectivité est plus une contrainte qu’un moins d’épanouissement, car comme le dit un proverbe africain « Tout ce qui se fait pour vous sans vous est contre vous ». Pour rendre la participation citoyenne effective, la consécration textuelle doit être accompagnée par l’aménagement de mécanismes d’apprentissage et de pratique permettant aux citoyens et aux élus locaux de mieux maitriser le concept et de l’utiliser, non seulement pour retarder les décisions ou projets de la collectivité territoriale, encore moins d’en faire un moyens pour anticiper les campagnes électorales mais, plutôt dans l’unique but d’assurer un développement stable et durable de la collectivité territoriale.
Par M . THIAW, Consultant juridique au 2CJ, contact : thmoctar@gmail.com
Share this content:


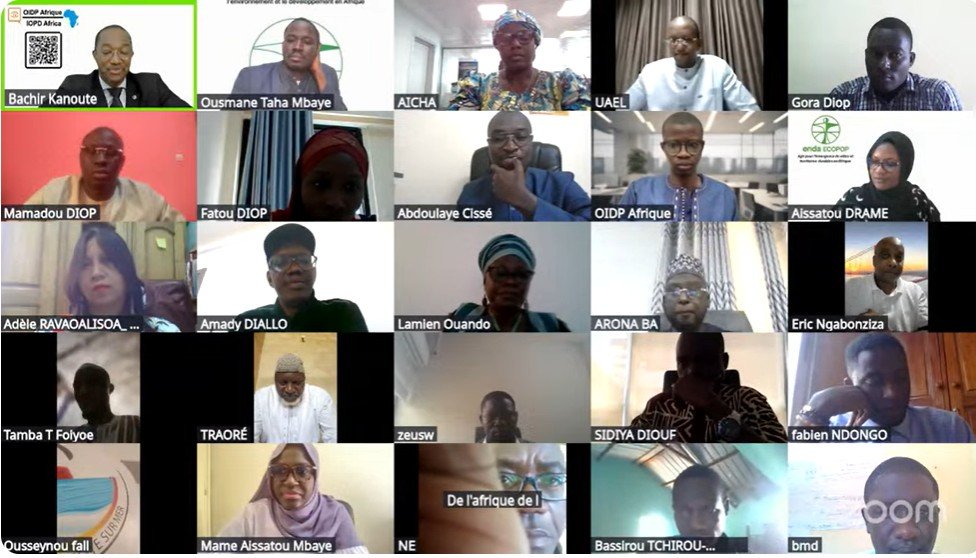



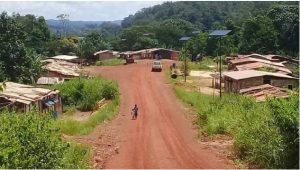







Laisser un commentaire