France : quel acte IV de la décentralisation ?
Une nouvelle étape de la décentralisation supposerait de revenir à de petites régions, d’améliorer l’accountability des exécutifs locaux, et de rendre plus transparente la répartition des services publics dans les territoires.
Fusionner départements et régions dans une taille intermédiaire
La première question à se poser, c’est celle de l’échelon et de sa taille. La fusion des départements et des régions est un serpent de mer, mais elle ne pourra se faire qu’à une taille raisonnable. Organiser le ramassage scolaire de la Lozère depuis Toulouse, ou les routes départementales des Ardennes depuis Strasbourg, ça ne pourra jamais marcher. Il faut de plus une cohérence culturelle des territoires.
Les grandes régions qui existent depuis 2015 sont trop grandes et participent au sentiment d’abandon de certains territoires. Pour fusionner les départements et les régions, il faudrait quelque chose de taille intermédiaire, correspondant à deux ou trois de nos départements actuels. C’est ce que Michel Debré avait proposé en 1947, avec 47 grands départements (à l’époque il n’y avait pas de régions).
Sans forcément reprendre son découpage, il y a des évidences : l’Alsace (plus peut-être la Moselle), la Franche-Comté, la Basse-Normandie, la Picardie, le Limousin, les deux Savoie, les deux Charentes… À chaque fois une métropole ou une grande ville dynamique, accessible à 2-3h maximum en voiture. Ces territoires seraient des collectivités et l’échelon de référence des administrations déconcentrées.
Des élus représentatifs et responsables
Le modèle français d’un exécutif local qui dirige la collectivité et les débats au sein de l’assemblée avait du sens avant la décentralisation quand presque tout était décidé par le préfet : l’assemblée était un contre-pouvoir au préfet. Mais aujourd’hui, le chef de l’exécutif est souvent un roitelet sans opposition. Plutôt qu’au Parlement, c’est dans les assemblées locales qu’il faudrait réduire le nombre d’élus.
Pour cela le scrutin départemental actuel est préférable à celui des régions. Élus sur leur nom propre, les élus départementaux des cantons sont moins godillots que ceux élus sur une liste, et ils sont un relai pour leur territoire. Si l’on veut de la proportionnelle, on pourrait passer au scrutin mixte allemand : une moitié de conseillers élus canton par canton, une autre moitié à la proportionnelle.
Ce mode de scrutin pourrait être étendu aux communes et aux intercommunalités, avec des conseillers élus quartier par quartier. Si l’on veut à la fois un exécutif local et une assemblée forte, l’alternative serait de les élire séparément (comme le Président et les députés). C’est ce qui se fait à Londres, avec un maire élu sur son nom propre, et une assemblée de 25 élus désignés par un scrutin mixte.
Des nouvelles compétences
Pour se rapprocher de nos voisins et donner de nouvelles compétences aux collectivités locales, il y a deux pistes évidentes : l’éducation et la sécurité, qui ne sont pas des compétences régaliennes (sauf éventuellement les CRS). On peut imaginer que les collectivités locales soient libres de définir leurs priorités locales pour l’école et la police (dans une certaine limite). L’État fournirait le budget, et le préfet mettrait en œuvre la politique décidée par les élus locaux. L’émulation stimulerait l’innovation.
Cela suppose évidemment une répartition juste des dotations selon les spécificités des territoires, mais aussi un « pricing » transparent des services publics. Cela ne sert à rien de donner plus de moyens aux ZEP en apparence si l’État dépense plus dans les lycées de centre-ville du fait des options rares et des enseignants plus expérimentés – et beaucoup mieux payés – qui choisissent d’y être mutés. De même, les métropoles devraient participer au budget universitaire des CHU si cela améliore les soins locaux.
Libre aux collectivités locales de réorienter une part des fonds d’une mission vers une autre, ou d’augmenter les impôts. Pour maintenir tel ou tel service public, il faudra faire des choix, mais c’est plus honnête et transparent que la situation actuelle décrite par Frédéric Bastiat en 1848 : « L’État, c’est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de vivre aux dépens de tout le monde. »
Par Charles Dennery (normalien, docteur en économie)
Share this content:

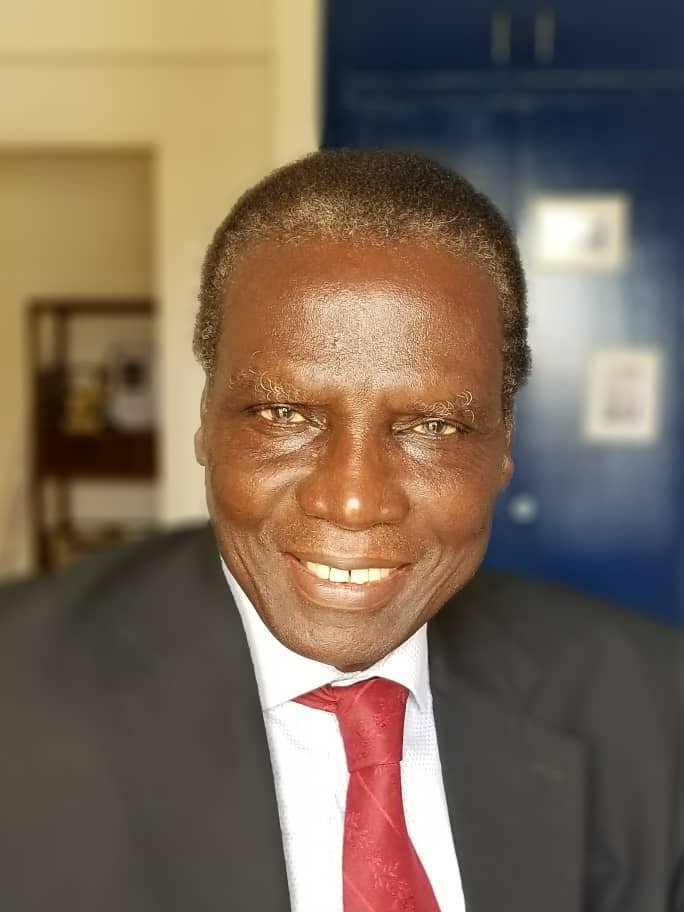



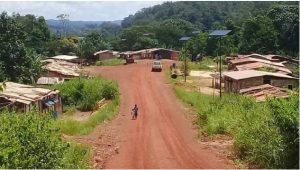







Laisser un commentaire