Contribution économique locale : des enjeux de développement a géométrie variable
En instituant la contribution économique locale, le législateur sénégalais cherche à simplifier le mécanisme de prélèvement d’impôts locaux sur l’activité économique. Aussi, souhaite-t-il accroître les ressources financières canalisées vers les collectivités territoriales par un meilleur rendement fiscal. Au-delà des volumes financiers en jeu et du souci d’équité territoriale soutenu par la recherche de critères pertinents de répartition entre les ayants-droits, l’avènement de la contribution économique locale (CEL) ainsi que la contribution globale foncière (CGF) rénovée, met en lumière un enjeu économique de développement territorial et projette durablement la question de l’autonomie fiscale des collectivités territoriales.
Relations entre fiscalité locale et développement économique territorial
Elus et développeurs économiques s’interrogent en permanence sur les conditions d’optimisation des retombées de l’impôt économique au niveau local. Force est de constater que les réformes portant sur la fiscalité locale n’ont pas encore permis d’engranger un couplage entre l’activité économique et les retombées fiscales dans les territoires. Les collectivités territoriales parviennent difficilement à dégager une capacité durable d’épargne et d’investissement sans apports des projets et programmes d’appui soutenus par les partenaires techniques et financiers.
Paradoxalement, nombre de collectivités territoriales présentent un fort potentiel fiscal. Mais elles peinent à mobiliser suffisamment de ressources financières propres. Ces dernières devaient leur permettre de faire face à la demande sociale et à l’investissement public local à même d’attirer l’investissement privé. Les économies locales semblent donc être dans une impasse. C’est comme si un cercle vicieux s’était installé : faible rendement de la fiscalité locale coïncidant avec une place congrue des ressources propres mobilisées et conduisant à une faible capacité d’investissement des collectivités territoriales. Finalement, les territoires, hormis Dakar, n’exploitent pas suffisamment les opportunités économiques. Le tissu économique local est peu dense et ne permet pas de tirer l’impôt local.
Sous ce rapport, il parait évident que pour mobiliser davantage d’impôts, des préalables s’imposent. D’abord, le lien activité économique – territoire doit être bien appréhendé. Ensuite, des stratégies d’ancrage territorial de l’activité économique doivent être établies. Enfin, nécessairement, des mécanismes durables d’observation du tissu économique doivent être mis en place sur le plan de la création de richesse incluant les acteurs et les dynamiques locales. Il n’est pas superflu d’affirmer que vouloir systématiquement optimiser le rendement fiscal au niveau local sans un accompagnement des entreprises existantes et leur promotion, revient à tuer la poule dans l’œuf.
L’autre question essentielle réside dans la promotion de l’établissement de bases de données intégrant des outils et méthodes d’observation des établissements du territoire aux fins d’une maîtrise consolidée du tissu économique. Dans cette dynamique, les collectivités territoriales peuvent s’engager dans une offre de programmes immobiliers à vocation économique. Dans ce domaine, l’expérience de Sandiara, dans le département de Mbour, offerte à titre d’exemple aux collectivités territoriales, mérite d’être capitalisée.
L’émergence de préoccupations en matière de gestion de portefeuille et de sites d’activités se traduit aussi par une diversification des produits immobiliers et par la territorialisation plus fine de l’action foncière et immobilière, surtout en milieu urbain. L’enjeu est de faciliter le parcours résidentiel de l’entreprise et le réseautage des activités économiques initiées sur le territoire.
C’est dire que toute réforme fiscale devrait s’inscrire dans une optique de l’ancrage territorial des chaînes de valeur, pour mieux prendre en compte la vocation de chaque territoire et valoriser les ressources locales. Cela revient justement à territorialiser les politiques publiques en vue d’expérimenter diverses stratégies à des échelles multiples. D’où la pertinence, le positionnement et la mission des futurs pôles-territoires. Au total, le développement économique territorial favorise la création de valeurs porteuses d’un potentiel fiscal pouvant conduire à une autonomie financière réelle.
La CEL renforce-t-elle l’autonomie fiscale ?
Le caractère synthétique de la CEL qui, pour rappel, est un impôt assis à la fois sur la valeur locative des locaux (CEL/VL0) servant à l’exercice des professions imposables et sur la valeur ajoutée (CEL/VA), conduit-il à une perte d’autonomie des collectivités territoriales ? La question mérite d’être soulevée d’autant que la patente constituait jusqu’alors l’une des principales sources de recettes de beaucoup de communes. La collaboration entre les exécutifs locaux et les centres fiscaux a permis, tant bien que mal, de recouvrer régulièrement des ressources budgétaires relativement importantes. Les acteurs territoriaux avaient ainsi une maîtrise de toute la chaîne fiscale. De la détermination de l’assiette jusqu’à la budgétisation, les différentes opérations administratives se déroulent sur le territoire, au plus, au chef-lieu de la circonscription administrative régionale.
Au gré de la nouvelle réforme fiscale, Dakar, la capitale, devient le centre de traitement et de distribution du rendement fiscal tiré notamment de la CEL, du fait de la position de l’Etat central dans le processus de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Rappelons que la TVA étant un impôt indirect sur les dépenses de consommation. Elle est payée par le consommateur et collectée par les entreprises qui participent au processus de production et de commercialisation. Dans sa répartition, comment l’Etat central va-t-il assurer une allocation basée sur l’équité et la solidarité ? Des critères pertinents sont certes en gestation, mais le recentrage du processus de traitement et de décision est de nature à soulever des inquiétudes de la part des Elus locaux et des partisans d’une décentralisation intégrale de la chaine fiscale locale.
Le renforcement de la politique de décentralisation requiert un transfert progressif de pouvoir de l’Etat central vers les territoires suivant une application efficace du principe de subsidiarité soutenu par une recherche permanente d’une proximité des centres de décision.
L’expérience tirée de l’évaluation des mécanismes de transferts financiers de l’Etat aux collectivités territoriales révèle quelques difficultés auprès des exécutifs locaux et leurs associations nationales respectives. Celles-ci relèveraient de la non-maîtrise des procédures et des modalités de détermination des enveloppes financières calculées sur la base de la TVA collectée par l’Etat dans l’évaluation annuelle du fonds de dotation de la décentralisation. Lequel fonds demeure le principal mécanisme financier de compensation des compétences transférées. Qu’on se comprenne ! L’objectif de rendement plus accru des nouveaux impôts locaux au profit des collectivités territoriales n’est pas remis en cause. La préoccupation est plutôt la perte de pouvoir de contrôle des territoires sur un pan important de leurs ressources propres tirées de la fiscalité locale et la disponibilité et la prévisibilité d’une recette somme toute déterminante.
En tout état de cause, osons espérer que, du fait de la réforme fiscale, l’augmentation attendue des ressources financières, sera à la hauteur des projections établies par le comité technique dédié, à pied d’œuvre, et les commissions de fiscalité locale performantes. Cela devrait conduire à une maîtrise de l’assiette et à l’établissement de rôles plus complets ainsi qu’à l’amélioration du recouvrement et, par conséquent, à plus de pouvoir fiscal des collectivités territoriales. Et pourquoi pas, à une refondation de la fiscalité locale couplée à une stratégie nationale de développement économique territorial ? Cela passe nécessairement par une professionnalisation de l’action économique sur les territoires. L’enjeu : consacrer la professionnalisation de l’action économique locale en organisant une véritable communauté professionnelle au service de l’efficacité des politiques publiques et des stratégies territoriales.
Par Oumar WADE, spécialiste en gouvernance et financement du développement territorial, ouwade@gmail.com
Share this content:


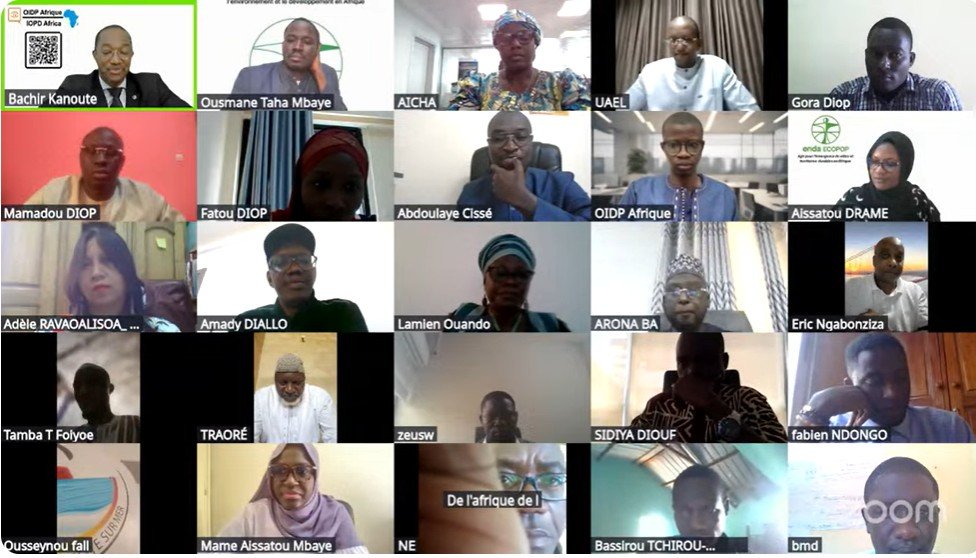



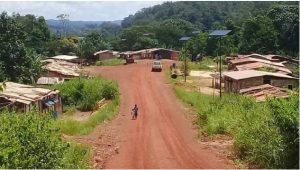







Laisser un commentaire