Bénin : Landry Faton, coordonnateur du programme ASCOM : « … nous avions eu raison de créer des radios communautaires.»
30 Décembre 2014, c’est à cette date qu’a pris fin la sixième phase du Programme d’Appui Suisse à la Communication Communautaire (ASCOM). Mise en œuvre par l’institut Kilimandjaro avec le soutien financier de la Coopération Suisse, ce programme durant sa mise en œuvre s’est évertué à accompagner plusieurs radios communautaires et institutions du Bénin afin de permettre à celles-ci de se faire un nom dans l’univers médiatique béninois. Landry Faton, Coordonnateur du programme, revient dans cette interview sur le bilan des actions mise en œuvre.
Que peut-on retenir du programme ASCOM ?
ASCOM est l’Appui Suisse à la Communication Communautaire. C’est un programme. Et un programme comporte beaucoup de projets. C’est un programme mis en œuvre par l’Institut Kilimandjaro sur financement de la Coopération Suisse. Il s’occupe de l’appui aux radios communautaires installées un peu partout dans le pays. Le programme apporte son appui à onze radios de façon directe et à quatre institutions. Il y a la FERCAB qui est la Fédération des Radios Communautaires et Assimilées du Bénin ; il y a le RIF qui est le Réseau International des Femmes des médias communautaires, affilié à l’AMARC entendu Association Mondiale des Radiodiffuseurs Communautaires. Comme nous appuyons des radios, le programme apporte aussi son appui à la HAAC, cette institution qui s’occupe de la régulation de la presse. Enfin nous appuyons aussi le ministère de la communication à travers sa direction générale du développement des médias.
Quelles sont les radios que vous avez accompagnées ?
Il faut dire que nous appuyons plus que onze radios communautaires. Puisque dans le cadre de l’appui que nous apportons à la FERCAB qui regroupe trente-six radios communautaires, nous appuyons donc de façon indirecte toutes les radios communautaires du Bénin. Les onze radios que nous appuyons (de façon directe) sont : la radio Mont Couffè de Bassila, la radio FM Noonsina de Bembèrèkè, la radio solidarité FM de Djougou, la Radio Su Tii Dera de Nikki, la radio Kandi FM de Kandi, la radio Alaketu de Kétou, la radio FM Ahémé de Possotomè, la radio Tuko Sari de Kouandé, la radio Idadu FM de Savè, la radio Orè-Ofè de Tchetti, et la radio rurale locale de Ouèssè.
On remarque qu’il s’agit plus des radios de la partie nord du pays. Est-ce bien cela ?
Au moment où la mise en œuvre du programme a démarré, il a fallu qu’on puisse voir sur le plan national les zones qui peuvent être intéressées par le programme. Il faut aller au début du programme pour comprendre. D’abord le programme est né pour venir en appui aux cinq radios rurales locales qui avaient été mis en place par l’ACCT. Il s’agit des radios rurales locales de Ouèssè, de Lalo, de Banikoara, de Tanguiéta, et de Ouaké. Mais au début, comme ce sont des radios qui sont gérées par l’ORTB, la collaboration pour pouvoir insuffler une nouvelle dynamique à ses radios n’avaient pas eu les résultats escomptés, ce qui a fait naître l’idée de profiter de la démonopolisation de l’espace audiovisuelle à travers la loi n° 97-010 portant libéralisation de l’espace audiovisuel en République du Bénin. Et en ce moment, nous avons, suivant l’ancien découpage, ciblé les six départements. Mais nous avons laissé le département de l’atlantique qui avaient déjà pleins de radios. Donc si nous prenons le département du Mono actuel Mono-Couffo, il y a la radio Ahémé de Possotomè ; dans l’Ouémé, actuel Ouémé-Plateau, il y a la radio Alakétu de Kétou ; le Zou, actuel Zou-collines, il y a la radio de Tchetti ; dans l’Atacora-Donga, il y a celle de Bassila, et enfin la radio Nonsina de Bembèrèkè. Donc c’est après cela que dès le début de l’année 2000, d’autres demandes ont été faites pour continuer d’appuyer d’autres radios communautaires.
Mais quelle a été la date exacte du démarrage du programme ?
Le programme a connu plusieurs phases. La première qui prend en compte les radios rurales locales a commencé depuis 1996 puisque ces radios ont commencé par s’implanter entre 1995 et 1996. Mais en son temps, c’était PACOM (Programme d’Appui à la Communication) toujours préfinancé par la coopération Suisse. Et c’est quand les difficultés ont commencé par naitre, qu’une deuxième phase a débuté pour rentrer dans la logique de mettre en place d’autres types de radios que nous appelons les radios communautaires. Le concept même de radio communautaire a été apporté au Bénin par l’institut Kilimandjaro entre 1997 et 1998. L’institut a fortement contribué au lobbying et au plaidoyer qui ont finalement abouti au vote de la loi N°97-010. Il reste donc un acteur clé du vote de cette loi. Et une fois que cette loi est votée, il y a donc le champ libre à l’installation d’autres types de radios. Et c’est en ce moment que nous avons profité pour inciter à l’implantation de radios qui seront gérées par les communautés elles-mêmes. Et ceci à travers une association que nous appelons Association de Promotions de Radios communautaires (APRC). Donc ces APRC se réunissent annuellement pour des assemblées générales de comptes-rendus et chaque deux ans ou chaque trois an selon le cas, il y a des assemblées générales de renouvellement de mandat. Donc, il y a un conseil d’administration qui nait de ces assemblées générales. Ce sont les APRC qui gèrent le quotidien de ces radios. De ces conseils d’administration, nait aussi le comité de gestion de la radio puisqu’un conseil d’administration de 15 ou de 20 membres ne peut pas gérer seul, il faut alors un comité d’à peu près 9 membres ou moins pour gérer. Donc la gestion du personnel est confiée à un directeur qui fait son équipe de direction. Actuellement, nous sommes à la sixième phase. La deuxième phase de 1998 jusqu’en 2000 a été la phase même de la mise en place de nouvelles radios que nous appelons radios communautaires. La phase 3 de 2000 jusqu’en 2004 a connu la conception et la mise en place d’outils de gestion, le renforcement de capacités, le recrutement du personnel de ces radios, la mise en place d’un type de gestion qui permet à ces radios de s’auto-gérer et d’assurer leur viabilité. Comme dans toutes entreprises il y a toujours des difficultés, les difficultés rencontrées au cours de ces trois premières phases ont amené la phase 4 qui normalement est une phase qui n’a pas trop duré. C’est une phase qui a permis de régler certaines choses qui n’avaient pas bien fonctionné au cours des phases précédentes. Mais cette fois ci, nous avons beaucoup plus mis l’accent sur des thèmes transversaux comme la gouvernance, le genre et même la lutte contre la pauvreté. Nous avons ainsi mis dans les lignes éditoriales de ces radios l’accent sur la communauté. Toutes les émissions devaient aborder les questions sur la lutte contre la pauvreté. Cette phase chainière que nous avons appelée 4 a aussi préparé la phase 5. Au cours de la phase 5, d’autres radios ont été insérées notamment 6. Ce qui fait que nous avons aujourd’hui onze radios communautaires que nous appuyons de façon directe. C’est aussi au cours de la phase 5 que nous avons commencé par appuyer les institutions. Au niveau de cette phase, l’accent a été mis sur la sécurisation des équipements que nous avons installés sur ces radios communautaires à travers la mise en place des parafoudres parce que les radios se plaignaient qu’il suffit d’un petit orage pour que les émetteurs se grillent et autres dommages. Ce qui touche plus les radios qui sont situées dans le nord et dans les collines. Donc cette phase a permis de mener des études qui ont permis de sécuriser les équipements. Nous avons profité de cette phase pour gérer l’autonomie de ces radios quant à l’énergie électrique. C’est au cours de cette phase que nous avons installé des groupes électrogènes de puissance qui relayent après la coupure du courant. La dernière phase est donc celle en cours qui est la phase 6. Cette phase qui a pris fin le 30 décembre 2014.
La phase 6 a essentiellement consisté a posé la problématique de la viabilisation des radios lorsque le programme ne sera plus là. Dans ce cadre, nous avons fortement contribué à l’achat de matériels pour les radios. Parce que ce sont des radios qui traversent d’énormes difficultés et qui n’arrivent pas à capitaliser les ressources pour financer un certain nombre de choses. C’est aussi au cours de cette phase qu’il y a eu la réhabilitation des bâtiments abritant les radios communautaires. La phase 6 nous a aussi permis d’intéresser les radios aux élus locaux, de créer le mariage entre les acteurs des radios et ceux des mairies. Dites vous que depuis l’avènement de la décentralisation où la gestion de la cité est descendue à la base, les mairies ou les élus locaux qui devaient profiter de ces organes de presse qui sont dans les communes pour communiquer avec les populations, ne le font pas de façon systématique. Donc nous avons essayé de montrer le bien fondé de ce mariage, les avantages que les élus locaux peuvent tirés de ces radios ceci pour deux raisons. La première raison est que ces radios leur permettent de communiquer, de rendre compte de leur gestion à la population et surtout dans les langues locales. La deuxième raison est que ces radios souffrent et donc, elles ont besoin de leurs soutiens pour aller de l’avant. En retour, les radios pourront mettre à leurs dispositions des plateaux pour des émissions. Au début, les mairies ont eu des difficultés à suivre car elles disaient qu’elles n’avaient pas prévu ces genres de contrat dans leurs budgets. Donc les premiers mois, c’est le programme qui a financé le passage des élus locaux sur les radios à hauteur de 400 milles francs par radio. Vu les résultats, les élus locaux ont accepté suivre et accompagner les radios. L’autre projet de la sixième phase a été de créer l’intercommunalité autour des radios. Quand nous prenons une radio comme celle de Nikki, elle arrose la commune de Nikki, de Pèrèrè, de Kalalé et c’est les mêmes groupes linguistiques. Donc on s’est dit pourquoi ne pas intéresser les autres mairies à la gestion de la radio pour qu’on ne parle plus de la radio communautaire de telle mairie mais de radio communautaire seulement. Et donc étendre les conseils d’administration de ces radios aux autres mairies. Désormais chaque commune à ses représentants au sein du conseil d’administration de la radio. On en a profité pour faire beaucoup de rencontres, beaucoup de plaidoyer auprès de ces maires pour leur expliquer le bien fondé de ces partenariats avec la radio. Et nous avons eu les résultats escomptés car aujourd’hui il n’y a pas cette manifestation au niveau d’une de ces radios sans qu’on ne voie un membre du conseil communal des autres communes. C’est aussi à cette phase qu’il y a eu le renforcement des correspondants locaux de ces radios en matière d’équipements, de formations en technique journalistique. Mais aussi de renforcer les antennes régionales de la HAAC.
Quel a été le rôle des acteurs institutionnels de cette dynamique médiatique communautaire ?
Nous travaillons de façon directe avec les radios. Mais c’est surtout la fédération qui a eu à contribuer fortement à la mise en œuvre du programme. A un moment, elle a commencé à s’intéresser à tout ce que nous faisons et nous aussi de notre côté, nous avons commencé par l’inclure dans nos activités. Quand nous lançons par exemple des appels d’offres, la fédération préside des commissions de dépouillement et autres donc elle nous aide beaucoup. La HAAC nous aide à la veille permanente et au respect des textes de déontologie et d’éthique dans les radios communautaires. Nous avons mis des ressources au niveau de la HAAC pour lui permettre d’assister systématiquement à nos ateliers et autres. Mais aussi pour faire des tournées périodiques surtout en période électorale. C’est d’ailleurs à l’actif de la coopération suisse, de l’institut Kilimandjaro qu’aucune des radios communautaires que nous appuyons n’a été interpellée par la HAAC en matière de déontologie. Aucune de ces radios n’a fait l’objet de poursuite par la HAAC.
Quelles sont les résultats que vous avez obtenus jusque là ?
Avant de venir aux résultats, il faut dire que le RIF a eu l’appui de la coopération suisse à travers le programme de regroupements des femmes des médias communautaires d’abord pour connaitre leurs préoccupations en matière d’épanouissements et d’appui technique. Et c’est dans ce cadre, qu’une quarantaine de femme de radios de proximités a été formée en technique de traitement photo numérique, en genre, en leadership pour que la promotion de la femme soit une réalité dans les communes béninoises.
Il faut aussi dire que le ministère de la communication a profité du financement apporté par le programme pour revenir au niveau des premières radios rurales locales, leur donner les notions un peu calquées sur les autres radios communautaires que nous appuyons. Leur apprendre aussi comment amener les populations à s’intéresser à la gestion des radios communautaires.
En termes de résultats, le premier résultat que personnellement j’ai noté, est d’abord l’existence même de ces radios. Elles n’ont pas fermé pour faute de gestion. Donc si les radios arrivent aujourd’hui à vivre et à fonctionner normalement, c’est un résultat fort. Le deuxième résultat, est que l’autre type de radios que nous avons initié, après 15 ans d’existence, a fait son chemin et nous prouve que nous avions eu raison de créer des radios communautaires qui sont gérées par les communautés elles-mêmes sans l’aide de l’Etat ni d’autres institutions. Nous allons aussi dire que ces radios sont gérés par des hommes des médias qui au fil de renforcement de capacités, de formations que nous organisons ont acquis de la matière, de l’expérience. Plusieurs sont les professionnels des radios communautaires qui ont eu à travailler au sein de la HAAC. Cette dynamique a continué et actuellement un conseiller issu des radios communautaires siège à la HAAC. Ce qui signifie que ces radios ont donc fait du chemin et les efforts portent leurs fruits. Donc ce sont des résultats en faveur de la coopération Suisse et de l’institut Kilimandjaro. Peut-être que s’ils n’avaient pas eu cette idée, ces personnes n’auraient pas eu des expériences et être dénichées. Même au niveau des communautés, les acteurs qui travaillent sont déjà si bien vus que parmi eux, il y a de plus en plus d’élus locaux. Parce que quand vous êtes à la radio et que vous abordez les questions liées à la commune de façon objective, on voit en vous un leader et on vous propose dans les instances de décision. Pour la promotion de la femme, Tchetti est même un exemple. Il faut dire qu’il y a une animatrice de la radio qui par sa performance a été proposée sur une liste et est actuellement chef village de Tchetti centre.
Quid des leçons à retenir de la mise en œuvre de ASCOM ?
Avant tout chose notons que l’institut est aujourd’hui le seul qui s’occupe au Bénin des radios communautaires. Donc, l’expérience dans ce domaine va en grandissant aussi bien pour l’institut que pour ceux qui y travaillent. Les acteurs peuvent désormais se positionner comme des consultants. Il faut aussi dire que c’est toujours bien de travailler avec les communautés même si beaucoup de choses restent encore à faire.
Des difficultés, vous en avez certainement rencontrées. Quelles sont-elles ?
Aucun travail n’est sans difficultés. Nous en avons rencontrés beaucoup mais notre force a été de trouver les moyens pour contourner ces difficultés. L’une des grandes difficultés que nous avons rencontrées est la collaboration avec les élus locaux. Parce que c’est des politiques et les associer à la gestion des radios n’a pas été facile. Ce sont des gens qui veulent contrôler les radios. Donc il y a eu beaucoup de séminaires et de rencontres pour leur expliquer que les radios sont des radios communautaires et non des radios communales. L’autre difficulté à été la mise à disponibilité à temps des ressources. Ce qui fait que si on fait une planification d’un an, le moment où les ressources viennent à notre disposition, est tard. Donc le temps qui nous reste ne nous permet pas de tout couvrir à temps. Mais on arrive à s’en sortir.
Avec la fin de ASCOM, à quoi doit-on s’attendre ?
Nous avons beaucoup de perspectives. Déjà le programme a été conçu par l’institut Kilimandjaro et présenté à la coopération Suisse. Donc l’institut entend en 2015 toujours continuer avec cette coopération en demandant des appuis dans plusieurs domaines. Et nous pensons qu’il ne faut pas attendre 2020 pour parler du passage de l’analogique au numérique des radios. On ne va pas attendre 2020 avant de faire toutes les sensibilisations qu’il faut et même les appuis institutionnels et techniques aux radios. Donc nous pensons solliciter les appuis pour vite venir en aide aux radios afin qu’elles ne soient pas au moment venu surprises de faire face à d’autres difficultés. Donc nous sommes déjà entrain de faire les documents à proposer à la coopération Suisse et à d’autres bailleurs qui veulent bien nous accompagner.
Il y a aussi la problématique de l’intercommunalité autour des radios que nous avons commencé mais que nous n’avons pas finit. Or c’est une problématique permanente. J’ai l’habitude de dire que les radios communautaires sont comparables à la démocratie. Si vous n’êtes pas là chaque fois pour les guider, elles deviendront une dictature. Donc il faut leur rappeler leur assemblée générale et autre. Malgré notre présence, il y a des radios qui ne sont pas à jour de leur assemblée générale de renouvellement de mandat. Donc imaginez quand nous ne serons plus là, ces radios deviendront les radios d’un clan. Ce que nous ne voulons pas. Nous travaillons encore à réécrire le programme toujours dans cette problématique de viabilité, d’appui aux radios pour le renouvellement des mandats, le respect des textes, le bon fonctionnement de ces radios. Donc notre programme sera toujours plus axé sur les radios de proximité. Nous pensons aller vers d’autres radios mais pas commerciales. Les radios communautaires n’ont pas de profit. C’est avec ce qu’elles gagnent qu’elles assurent le fonctionnement de l’organe. Or il y a des radios communautaires qui font 700 francs de recettes journalières. Ce qui n’est pas normal. Il faut donc les appuyer et les accompagner surtout que ce sont des radios qui sont déjà ancrées dans les habitudes des communautés. L’autre perspective est que la coopération Suisse ainsi que d’autres partenaires tels Social Watch veulent mettre en place un programme de redevabilité à l’endroit des radios communautaires, des élus locaux. Donc l’institut veut participer à cela surtout dans le volet suivi et renforcement de capacités pour suivre avec eux la mise en œuvre de ce programme.
Réalisé par Perpétue Houéfa AHOMANGNON
Share this content:






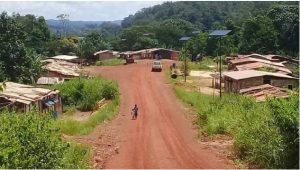







Laisser un commentaire