France – Constitution : les collectivités cherchent encore leur place
Au moment où la loi fondamentale de la Vème République fête ses 60 ans, retour sur la longue marche vers la République décentralisée. Un principe inscrit, dans une rédaction minimale, à l’article 1er de la Constitution depuis 2003. Ce mouvement devrait être prolongé par un droit à la différenciation à l’occasion de la prochaine révision. Reste à faire entrer ces beaux préceptes dans les faits.
Dans les soubresauts de l’affaire algérienne et du retour aux manettes du général de Gaulle, les collectivités sont le cadet des soucis des constituants du 4 octobre 1958.
Elles trouvent bien leur place à l’article 24 selon lequel le Sénat assure leur représentation. Les départements et les communes sont également mentionnés à l’article 72. Mais, aux yeux du père de la loi fondamentale, le très gaullo-jacobin Michel Debré, les collectivités apparaissent comme un simple démembrement de l’Etat. Au mieux, une filiale, au pire, un prestataire du pouvoir central.
C’est paradoxalement un homme qui se revendique de l’héritage gaulliste, Jacques Chirac, qui fait voler en éclats cette conception dans la loi fondamentale. Président de la République, il impose, avec la révision du 28 mars 2003, l’introduction des libertés locales aux articles 72 et suivants.
Au menu : le droit à l’expérimentation, la prime à la subsidiarité, la possibilité de créer en métropole des collectivités à statut particulier, l’autonomie financière… « Jusqu’alors, la décentralisation était administrative et donc cantonnée à un pouvoir de gestion. Avec cette révision, c’est une nouvelle architecture des pouvoirs qui est préparée, les collectivités voulant se rapprocher des exemples européens », se félicite la constitutionnaliste Géraldine Chavrier.
L’APPAREIL D’ETAT FAIT DE LA RÉSISTANCE
Le Premier ministre d’alors, Jean-Pierre Raffarin, ne parvient cependant pas complètement à ses fins. L’appareil d’Etat fait de la résistance. « Certains des propres collaborateurs du Premier ministre, issus du corps préfectoral, sont réservés, sinon hostiles, à son projet », relate le politologue Patrick Le Lidec. Particulièrement en cause : la volonté de proclamer, à l’article 1er de la Constitution, que la République est décentralisée. Une petite révolution.
« L’article 1, qui fixe les valeurs de la République, affirmait, avant cette révision, l’unité de la République. La libre administration des collectivités n’apparaissait, elle, qu’en termes techniques à l’article 72. Le Conseil constitutionnel faisait donc toujours prévaloir l’unité de l’article 1 sur la libre administration de l’article 72 », souligne Géraldine Chavrier.
D’emblée, le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas possible d’affirmer le caractère décentralisé de la République. C’est le directeur général des collectivités locales, Dominique Bur, qui suggère de contourner le problème en insérant à l’article 1er de la Constitution la mention selon laquelle c’est simplement l’« organisation » de la République qui est « décentralisée », et non la République.
L’AUTONOMIE FINANCIÈRE EN QUESTION
« Il y a, c’est vrai, un débat juridique assez fort, confirme Jean-Pierre Raffarin. J’aurais préféré affirmer de manière plus explicite le principe de subsidiarité. Mais il me faut garder de bonnes relations avec l’appareil d’Etat. J’ai une nomenklatura administrative qui est plutôt jacobine. Nous privilégions donc une rédaction consensuelle. »
Plus grave, le principe d’autonomie financière, affirmée dans la révision du 28 mars 2003, est vidée de sa substance par une loi organique ultérieure. Pour Patrick Devedjian, ministre délégué aux Libertés locales au moment de la révision de 2003, il y a, en sus, un coupable tout désigné : les « sages » du Palais-Royal. « Le Conseil constitutionnel ne veut pas appliquer la Constitution », s’agace-t-il.
Toute la section juridique de l’appareil d’Etat est, selon lui, à l’avenant. « Quand nous avons présenté notre révision de 2003, le Conseil d’Etat, en Assemblée générale, a donné un avis défavorable. Il se conduit, non pas en juriste, mais en chambre politique. Le Conseil d’Etat est le cœur du jacobinisme français », tempête Patrick Devedjian.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, ÉLOIGNÉ DES COLLECTIVITÉS ?
Mais pour Géraldine Chavrier, les esprits ont évolué depuis 2003. « L’exécutif actuel a envisagé d’autoriser les collectivités à adapter les lois et les règlements à leur situation sans limitation de durée, et le Conseil d’Etat qu’il a saisi y a vu une souplesse pour les collectivités », relève-t-elle.
Emmanuel Macron se fait d’ailleurs le chantre du droit à la différenciation locale. Un principe qu’il souhaite inscrire dans la prochaine révision constitutionnelle. Une réforme dont l’examen au Parlement a été repoussée au mois de janvier 2019.
Le droit à la différenciation marquera-t-il le début d’un nouveau monde pour les collectivités ? Patrick Le Lidec affiche ses réserves : « Croire qu’une révision constitutionnelle va produire des d’effets mécaniques relève de la pensée magique. Une constitution ne peut pas prévoir l’interprétation qui en sera faite. »
Et Patrick Le Lidec, d’ajouter à propos de la réforme de 2003 : « Si Jean-Pierre Raffarin avait obtenu une transformation des mécanismes de nomination au Conseil constitutionnel, en accroissant la proportion des membres nommés par le Sénat ou en faisant désigner un membre par les collectivités locales, il aurait sans doute obtenu plus de résultats. »
lagazettedescommunes.com
Share this content:





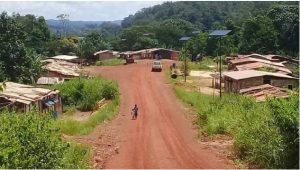







Laisser un commentaire