Planification locale : défis et perspectives pour un développement durable
La planification locale est l’élément central du processus de développement local. Elle permet de déterminer les actions à mettre en œuvre pour améliorer des conditions de vie populations locales. A ce titre, elle aide les collectivités locales à remplir plus efficacement leur mission principale qui est : « la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental d’intérêt local ».
Auparavant, réalisée avec l’appui des services techniques de l’Etat, l’élaboration des documents de planification a été transférée en 1996 aux collectivités locales en faveur de « l’acte 2 » de la décentralisation qui consacre la création des régions collectivités locales (CL). Ce transfert marque un tournant décisif et montre la volonté de l’Etat de renforcer le rôle des CL dans le développement local.
En 2013, le Code Général des Collectivités locales (CGCL) qui consacre la mise en œuvre de l’acte 3 de la décentralisation a au-delà des transferts défini les rôles et responsabilités des acteurs territoriaux. Pour la planification, cela constitue une avancée majeure dans la pratique de cet exercice. L’acte 3 s’inscrit dans un contexte de mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) et des ODD adoptés en 2015. Dans ce contexte actuel, l’interrogation est de savoir quelles doivent être les priorités pour assurer un meilleur apport de la PL à la réalisation d’un monde plus durable et à une réduction des inégalités.
Importance de la planification locale dans le contexte actuel
Le contexte actuel en matière de développement est caractérisé par 03 faits majeurs : les adoptions du PSE et des objectifs de développement durable (ODD) et le renforcement de la politique de décentralisation avec la mise en place de l’acte 3.
Le contexte international est caractérisé par l’adoption en septembre 2015, par la communauté internationale, des (ODD) qui prennent le relais des OMD arrivés à terme en cette même année. Cette adoption des ODD engage les acteurs à tous les niveaux car le message phare qui est « ne laisser personne en rade » suppose l’atteinte des objectifs à tous les niveaux (mondial, sous régional, national, local,) et pour tous.
Au niveau local, la poursuite de ces ODD interpelle sur les outils et stratégies à mettre en œuvre à cet effet. C’est dans ce cadre que la planification locale qui encadre l’intervention au niveau territorial reste un outil d’une importance capitale. En effet, dans une collectivité qui respecte la cohérence de sa chaîne de planification, la prise en compte des ODD dans le document de planification se traduit par une budgétisation et un investissement sensibles aux ODD et donc une maximisation des chances de leur atteinte.
En 2018, le Sénégal vient de réaliser son deuxième plan d’actions prioritaires (PAP 2019-2023) du PSE qui a permis de mobiliser quelque 7000 milliards. La concrétisation des objectifs du PSE au niveau local reste toutefois en partie imputable à la bonne cohérence entre le PAP du PSE et le PAP du PDD ou PDC. Cette situation implique la nécessité d’une bonne prise en compte du PSE dans les documents de planification locale et en retour, l’importance de la planification locale dans la réussite du PSE.
Enfin, l’acte 3 de la décentralisation devrait se traduire dans sa deuxième par la mise en place de pôles territoires. Par ailleurs, pour accompagner les collectivités locales, l’Etat prévoit de mettre en œuvre le Programme d’appui aux agglomérations et aux communes (PACASEN). Ce projet comptant accompagner les collectivités locales pour les rendre plus autonomes et plus aptes à répondre aux besoins des populations se traduira en partie par le financement de plusieurs projets. Ainsi, il importe de faire au niveau local le ciblage des actions les plus pertinentes et les plus efficaces et pour ce faire, la planification locale reste l’outil le plus adéquat.
En somme, le contexte actuel est favorable au développement de la planification locale. Toutefois, quelles sont les avancées sur lesquelles les acteurs peuvent se baser ?
Avancées dans planification locale
Plusieurs avancées sont notées dans le domaine de la planification locale. Celles-ci portent sur la responsabilisation des acteurs locaux, l’harmonisation des processus de planification locale, la conception d’outils et la mise en place d’un cadre regroupant les principaux acteurs.
En 2013, l’Etat a dans le cadre de l’acte 3 de la décentralisation, précisé que l’élaboration des PDD est dévolue aux départements et les PDC aux communes. Ainsi, au-delà des transferts, les responsabilités des acteurs sont clarifiées, ce qui permet une intervention plus claire.
Pour ce qui est de l’aspect pratique, deux faits majeurs sont notés que sont l’existence d’un guide de la planification locale et la mise en place de comités technique régionaux de planification. Le guide de la planification locale a été élaboré et partagé par le Programme National de Développement Local (PNDL). Il est en cours de révision et devrait s’enrichir des dimensions transversales telles que le changement climatique, la nutrition, la migration et le genre, ce qui devrait contribuer à enrichir la qualité des documents de planification.
Les comités techniques de planification coordonnées par les agences régionales de Développement (ARD), bras techniques des CL et composés des principaux services techniques transversaux, sont mis en place dans toutes les régions. Ils encadrent les processus et garantissent la qualité des documents de planification.
Pour un meilleur accès à l’information territoriale, deux initiatives sont notées avec le Programme National de Développement Local (PNDL) et l’Agence de Développement Local (ADL). Le PNDL a mis en place l’outil IR2P qui est utilisé dans l’élaboration des documents de planification locale. L’ADL est en train de mettre en place l’observatoire national des territoires (ONT).
En résumé, des avancées tangibles sont notées dans le domaine de la planification locale. Cependant, plusieurs contraintes freinent l’apport de la planification locale au développement locale
Les défis
Les principaux défis à une bonne planification locale portent sur l’accès difficile à l’information, le déficit en ressources humaines et financières au niveau territorial.
Faire un diagnostic équivaut à répondre à la question où est-ce qu’on en est ? La réponse à une telle question se heurte essentiellement aux limites du système national de suivi-évaluation et à la centralisation des politiques publiques.
Bien que depuis 2005, le Sénégal ait entrepris la gestion axée sur les résultats comme approche de gestion de son développement, le suivi du développement est plus basé sur des indicateurs dont l’information n’est pratiquement disponible qu’au niveau national. Pour l’essentiel, seuls quelques indicateurs sectoriels sont disponibles pour les CL.
Le transfert des 09 domaines de compétences est effectif depuis 2016. Seulement, la principale complainte des CL est que le celui-ci ne s’est pas accompagné d’un transfert concomitant de ressources. Ainsi, les ressources des CL qui proviennent essentiellement de la fiscalité locale et des transferts de l’Etatsont assez faibles.
Pour ce qui est des ressources humaines, les collectivités locales s’appuient sur le conseil et ses commissions et sur le personnel technique. Les collectivités locales ont souvent 04 commissions au moins comme recommandé par le CGCL de 2013. Cependant, la fonctionnalité de celles-ci est faible car les élus n’ont pas toujours la formation adéquate. Tandis que pour ce qui est du personnel technique, il se résume, pour l’essentiel des collectivités locales, au secrétaire municipal qui appuie le maire.
Face à cette situation, les ARD ont été mises en place pour les appuyer. Toutefois ces entités ne jouent pas encore pleinement leur rôle à cause du déficit de personnel et de ressources financières.
Implications des déficits en informations territoriales et en ressources humaines et financières sur le processus de planification locale
Le déficit en ressources humaines et financières et de l’accès difficile à l’information territoriale ont des implications réelles sur le processus de planification.
Pour le diagnostic, l’instrument de recensement rapide de la plateforme IR2P mis en place par le Programme National de Développement Local (PNDL) permet un bon répertoire des infrastructures et parfois de leur gestion mais ne parvient pas à fournir une quantification des productions. Ainsi, les informations glanées dans ce processus ne suffisent pas pour faire un bon état des lieux. L’absence d’une bonne information a donc pour principale implication la difficulté à faire un état des lieux correct.
Il est clair que si l’on ne sait pas réellement où on est, il est pratiquement impossible de savoir où on pourra se retrouver demain. A titre illustratif, il est quasiment impossible de savoir les quantités de productions agricoles, animales ou halieutiques d’une commune donnée. Ainsi, les visions proposées sont certes parfois en cohérence avec les valeurs, souhaits et aspirations des populations mais en quoi peuvent-elles être réalistes si on ne maîtrise pas vraimentle présent ?
Les ateliers de planification permettent de définir la vision et enfin le plan d’action pour la réaliser. Cependant ils sontle plus souvent des séances de consolidation des besoins des populations. Ainsi, les plans d’actions sont hors des capacités financières des collectivités locales. En outre, des séances de vulgarisation ne se font pratiquement jamais, ce qui empêche le captage de financements nécessaires à sa concrétisation.Les plans d’actions qui sous-tendent les documents sont aussi problématiques.
Pour renforcer la cohérence territoriale des interventions, les conférences d’harmonisation sont prévues par le (CGCL). Cependant celles-ci ne se tiennent pratiquement jamais. Ainsi, les interventions des acteurs territoriaux ne correspondent pas aux prévisions d’investissements inscrits dans les PAP.
Il est constant de voir que certains des investissements du conseil municipal ne sont pas inscrits dans le PAP. Ceux des autres acteurs pour l’essentiel ne sont pratiquement en liaison avec le PAP. Ce constat dans les interventions a conduit le PNDL à inclure la cohérence entre le PDD ou PDC et le budget comme critère de bonne gouvernance territoriale.
Conclusion
Il est clair qu’un développement territorial ne peut se faire sans un bon système de planification. Cependant, bien que des avancées notoires soient réalisées dans l’encadrement du processus et la responsabilisation des acteurs, des défis énormes subsistent.
Le plus grand défi reste l’accès à l’information territoriale. Cette situation empêche la réalisation d’un diagnostic adéquat et la définition de stratégies pour un mieux-être des populations.
Le manque de ressources humaines et financières des collectivités locales, le déficit de communication et le déficit de rencontres de suivi du développement locaux handicapent la mise en œuvre des documents de planification.
Ainsi, les priorités pour améliorer la contribution de la planification au développement locaux sont :
- La mise en place d’un système de suivi du développement local ;
- Le renforcement des capacités de mobilisation de ressources financières des collectivités locales ;
- Le renforcement des capacités des acteurs territoriaux pour assurer la bonne conduite des processus de planification.
Concernant le suivi du développement territorial, il s’agira pour le niveau sectoriel de déployer le système de suivi à l’échelle locale. Le projet de compilation pourra être porté au niveau territorial par le CTR de planification qui aura ainsi pour responsabilité de mettre en place pour chaque collectivité locale une base de données mise à jour régulièrement. Ceci facilitera à la fois le suivi des disparités et donnera l’état des lieux réels de toutes les collectivités locales. Il devrait aussi permettre d’orienter les interventions des acteurs pour un développement local plus harmonieux.
Les ressources financières des collectivités locales sont encore faibles d’où l’intérêt de mettre en place les commissions de fiscalité locale pour renforcer la mobilisation des ressources internes. Ensuite, les transferts devraient être renforcés et les contrats plans promus. Enfin, le CTR devrait accompagner les collectivités dans la conception de fiches de projets pour intéresser les partenaires.
Les capacités des acteurs devraient être régulièrement renforcées en planification et en suivi du développement. Ainsi, les capacités des CTR doivent être bien renforcées en planification et en suivi pour renforcer la qualité de l’encadrement du processus. Au niveau des collectivités locales, les capacités des membres des commissions de planification doivent être renforcées de même que celles des secrétaires municipaux à qui le suivi du développement local pourrait être confié.
Cheikh Niang
Expert en gestion de la politique économique
Chef du Service régional de la Planification de Ziguinchor
Cniang2010@gmail.com
Share this content:


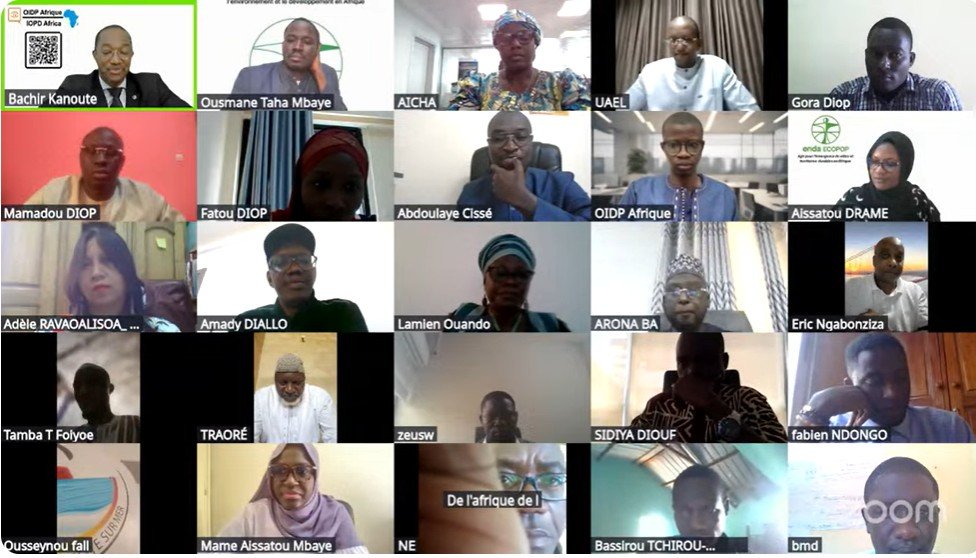



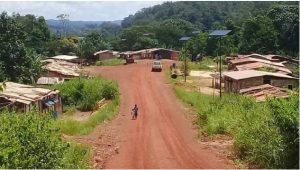







Laisser un commentaire